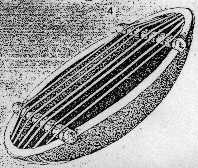
Afrique
lieu
date
peuple et civilisation
"Le cymbalum est un instrument tzigane
typiquement hongrois." Voilà comment il est régulièrement présenté au
public. Mais comme son histoire le prouve, la réalité est beaucoup plus
complexe.
Le cymbalum est un instrument cordophone et
non une percussion. Il fait partie de la famille des cithares. Les cithares sont
des instruments sans manche, à cordes pincées ou frappées, montées sur une table
de résonance. Dans cette famille on trouve également le clavecin et le piano. Le
cymbalum a les cordes tendues parallèlement à la caisse sonore et dans toute sa
longueur. Selon la taille, la forme, la technique d'utilisation, l'époque et le
pays, l'instrument est désigné sous des noms différents, on en compte plus de
200. Tous les chercheurs et les musicologues ne s'accordent ni sur le classement
ni sur l'appellation de ce groupe particulier d'instruments qui va du psalmos
de l'Antiquité au
Zimbalo ungherese, nom du cymbalum hongrois.
L'histoire commence il y a bien
longtemps. Les formes les plus primitives existent encore en Afrique ce sont les cithares en cuvette, en
berceau... Ces instruments ont une caisse de résonance, et les cordes sont
tendues parallèlement à la caisse, la recouvrant sur toute sa longueur. On
frappe ou on pince les cordes de boyau ou d'écorce.
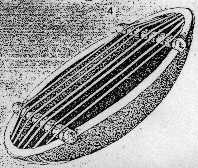 |
Instrument à berceau
Afrique |
L'ancêtre du cymbalum vient d'Asie. La trace la plus ancienne a été trouvée dans l'ancienne Mésopotamie, l'actuel Irak, elle date de 3000 avant J.C. Des archéologues ont trouvé un vase décoré, où un prêtre joue de cet instrument en le pinçant.
En Egypte aussi
on a trouvé dans une pyramide une peinture murale qui représente cet instrument.
Les musiciens étaient toujours des jeunes femmes. Sur ce dessin on voit donc une
femme qui tient l'instrument d'une main, et qui de l'autre frappe avec une
baguette. Un autre exemple est un bas-relief, concervé
au British Museum de Londres, datant VIe-
VIIe siècle avant J.C. Il représente un défilé de victoire
devant le roi Assurbanipal. Les musiciens tiennent leur instrument
horizontalement fixé devant eux à la hauteur de leur taille et frappent avec
deux baguettes, exactement comme le petit cymbalum au
XIXe siècle en Hongrie.
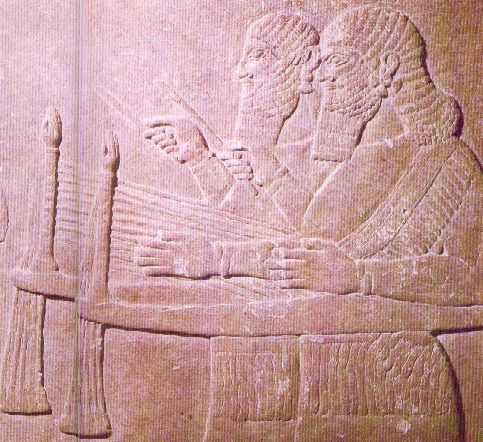 |
Bas-Relief Assyrien
705-681 av.J.C Musiciens à la tête d'une procession religieuse Palais de Sennachérib. Ninive |
Cet instrument est cité plusieurs fois dans
la bible sous le nom de nebel ou mizmar. Par
exemple, le roi David en 1000 avant J.C. a joué de
cet instrument. Il était un très bon musicien et il a composé beaucoup de
psaumes. Un psaume c'est un chant religieux accompagné par un instrument à
cordes pincées.
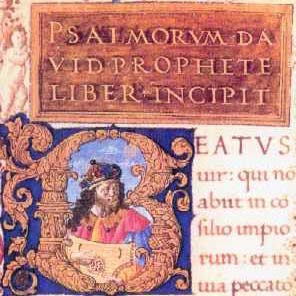 |
Francesco Cherico
Psautier enluminé fin du Xve Bibliotheca Corviniana |
Plus tard, dans l'Antiquité les Grecs ont beaucoup utilisé cet instrument et l'ont appelé psalmos. C'est de là que vient le nom, encore utilisé de nos jours : le psaltérion.
Durant l'Antiquité et le Haut Moyen Age le terme grec psalmos ou psalterion désignait indifféremment plusieurs sortes d'instruments à cordes pincées tendues sur un support triangulaire,quadrangulaire, ou en forme de "tête de cochon". Ou était composé d'une caisse de résonance de forme trapézoïdale entièrement en bois à table plate et à dos concave dont la taille pouvait atteindre 80 cm . Le nombre des cordes en boyau ou en veine variait de 5 à 15.
D'aprés la légende, Schéhérazade en
acompagnait ses récits dans les contes des Milles et Une Nuits, écrits au Xe siècle durant la 49 eme et la 169eme nuits.
"...elle pinça un instant les cordes vibrantes et , d'une
voix pleine de délices et plus douce que la brise et plus agréable et plus pure
que l'eau de roche, elle chanta..."
A partir de cette souche originelle, ce groupe d'instrument va se répandre dans le monde avec les grandes migrations de l'Histoire, les invasions, les croisades...
Souvent modifiés, enrichis, par les nouveaux adeptes, ils reviendront croiser la route de leurs ancêtres. En Europe on compte deux groupes majeurs d'instruments: les psalterions et les tympanons. En Orient le quânûn arabe est très largement répandu, ainsi qu'au Proche Orient et en Afrique du Nord.
Ce dernier est composé d'une soixantaine de
cordes et il est accordé à la gamme
diatonique, les plaquettes
ou les clés permettent d'accorder les cordes d'un quart de ton pendant le
jeu. Les cordes sont pincées à l'aide d'onglet en corne, en écaille ou en métal.
La main gauche pince les cordes avec un léger retard sur la main droite de façon
à créer une hétérophonie syncopée.
Il parvient en Europe au Moyen
Age en passant par l'Espagne. Le musicien peut
être soliste, s'intégrer dans un ensemble ou accompagner le chant
classique.
 |
Cinq instruements dont
trois psaltérions de formes différentes. Musiciens et danseurs à la cour d'Alphonse X le Sage XIIIème Cantigas d'Alphonse Monastère de l'Escurial,Madrid |
Comme l'écriture des partitions n'a
été mise au point qu'au Moyen Age, même si on a des
représentations en peinture ou en dessin, on ne sait pas bien quelle musique
était jouée avec ces instruments. Mais des chercheurs ont trouvé une vieille
partition qui date de la Grèce Antique, qu'ils ont pu
décripter. C'est le plus ancien souvenir musical de l'humanité, que l'on
connaisse aujourd'hui. Ecoutez bien ce très vieil hymne grec.
MUSIQUE
Plus tard le psalmos s'est répandu en Europe avec les chrétiens. C'est par les Arabes que le santour est
arrivé au sud de l'Europe et en Espagne. Les Arabes l'ont fait connaître aussi dans leurs voyages vers
l'Extrême Orient jusqu'en Chine. D'ailleurs les Hongrois
ont connu cet instrument chez les Arabes à Byzance. Puis ils l'ont introduit en Europe centrale au moment des Grandes Invasions et l'ont
conservé jusqu'à nos jours dans leur culture.
Le
santour, qui en langue perse signifie "cent cordes", est également
un instrument arabe. Il
est fréquent en Iran, Irak
et Turquie. Il suivit le même chemin que le psalmos à travers le monde. On
trouve aujourd'hui ses descendants au Japon, en Mongolie, en Afghanistan, en Inde, en Corée ...
L'instrument
d'origine assyrienne
et hébraïque, suit en Europe le même chemin de propagation que le quânûn. Au Moyen Age il pénétrera en Espagne et en Europe centrale. Il possède de 20 à 72
cordes, avec jusqu'à 60 chevilles
fixées. Il est monté sur un support généralement à quatre pieds. Les cordes sont
frappées avec deux maillets légers. Les musiciens traditionnels jouent
essentiellement du poignet utilisant les baguettes droites.Cette technique fut
réinventée par le maître hongrois Rácz Aladár au début du XXe siècle.
La création de
l'instrumento di porco amena de nombreux changements. Les
musiciens l'utilisaient en pinçant les cordes avec un plectre ou
avec leurs doigts, ou les deux à la fois. Dans ce dernier cas la main droite
tient le plectre et joue sur une ou deux cordes tandis que la main gauche gratte
les cordes libres. Quand le musicien utilisait deux plectres, les peintres de
l'époque le représentaient en haut du tableau entre les musiciens jouant la
mélodie.
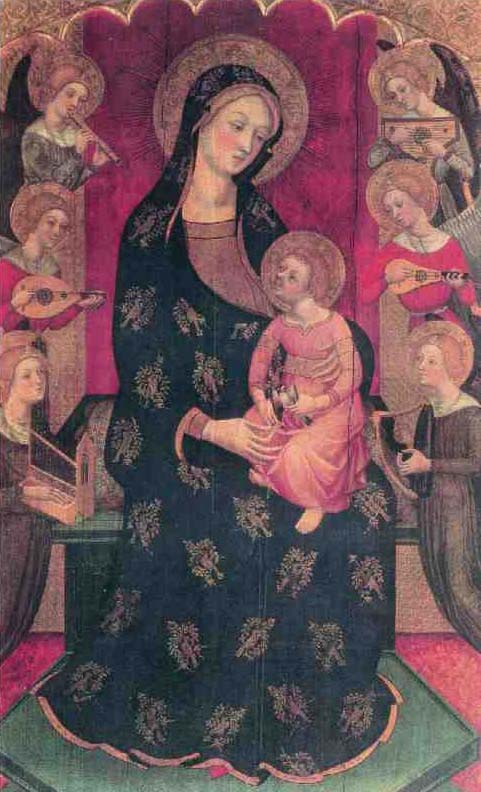 |
La Madone à
l'Enfant Peinture catalane du XIVe siècle Barcelona |
Quand il joue avec
ses doigts nus il fait résonner les accords et
il est alors représenté en bas de la peinture entre les musiciens jouant
l'accompagnement.
 |
Juan de Séville
Madonna à l'Enfant Jésus entourés des anges musiciens détail d'un Tryptique XVe siècle Museo Làzaro Galdeano, Madrid |
Athanasius Kircher dans
Musurgia universalis en 1650 affirma que l'instrumentaliste du psalterion pouvait jouer des
musiques polyphoniques.
Jusqu'à la Renaissance, les cordes étaient en boyau. L'instrument donnait un son très doux, d'où son nom dulce melos, qui devint plus tard dulcimer. Dulce melos est cité pour la première fois dans le manuscrit de l'Escurial "Los cantigas de Santa Maria" datant du XIVe siècle et dulcimer dans un poème anglais, "The Squyr of Lowe Degre". Les musiciens l'utilisaient lors des messes en pinçant les cordes. L'instrument pouvait être soit tenu contre le corps, soit posé sur les genoux.
A partir de 1350, suite à l'accroissement de la demande de l'industrie textile, les perfectionnements apportés à la fabrication des fils métalliques en Allemagne, les rendirent plus disponibles et accessibles à tous, y compris aux musiciens. Les cordes de boyau du psalterion ont pu être remplacées par des cordes métalliques en Europe de l'Ouest.
A partir du XIVe
siècle, avec l'apparition des cordes métalliques, le tympanon
était posé sur une table et frappé avec de fines baguettes de
bois.
Les deux types d'instruments, psalterion pincé et tympanon frappé, se développeront parallèlement. Le dulce melos méditerranéen à cordes de boyau a une sonorité chaude, douce, sourde et de courte durée. Le psalterion gothique à cordes métalliques a une sonorité froide, métallique et de longue durée. En raison de sa forme et de cette sonorité, les italiens l'ont appelé par dérision, instrumento di porco, puis au XVIIe salterio tedesco, c'est à dire salterio allemand.
Il est intéressant
de mettre en relation l'impossibilité de pincer longtemps avec ses doigts des
cordes de métal et l'arrivée dès 1404 d' instruments capables de faire cela mécaniquement : le
clavicorde, l'épinette et le clavecin. Plus tard le martèlement aussi pourra se
faire indirectement comme dans le cas du piano, qui est donc le descendant du
tympanon, du Hackbrett et du cymbalum.
En Europe les musiciens utilisaient cet instrument pour les
cérémonies liturgiques en pinçant les cordes. A partir du XIVe siècle on jouait en frappant avec de fines baguettes
de bois. Le cymbalum fût très populaire. On le trouve représenté sur de
nombreuses peintures, ainsi que dans de vieux manuscrits, dans la main des
anges, des apôtres et même de l'enfant Jésus.
 |
Jacob van
Ootzanan Adoration de l'enfant Jésus 1512 détail Museo du Capodimonte, Naples |
| Maître du Haut
Rhin La vierge et l'enfant XIVe Städelsches Kuntsinstitut, Frankfurt. |
 |
Cependant au XIIe siècle l'orgue remplaça progressivement le psaltérion dans les églises.
Dans son Décameron écrit entre 1349 et 1353, Boccace fait référence à certaines chansons qu'on jouait au psalterion, le cinquième soir par exemple. Dans les archives de la cour d'Alfonse X (1252-1284) il est fait mention de nombreuses fois de joueurs de "quânun". Ainsi, jusqu'à la fin du XIIIe siècle il est fréquemment utilisé par les troubadours pour accompagner leurs chants.
Ma dame Musique aus clochetes
Et si clerc plain de chanconnetes
Portoient gigues et vieles
Salterions et fleüteles.
Le tympanon dés le XVe
siècle il est devenu l'instrument de la noblesse par excellence. Dans
chaque château le psaltérion était l'instrument de loisir incontournable pour
les femmes nobles.
 |
Symphonie du
thympanon, du Luth et de la Flûte d'Allemagne.
"Un Concert est charmant lors qu'il est bien d'accord Et qu'on scait justement suivre sa tablature; Mais il est bien plus doux, ou je me trompe fort, Quand l'amour prend plaisir de battre de la mesure." XVIIIème |
Au XVII - XVIIIe siècle l'instrument
commençât à connaître une renommée constante: compositions originales de Paolo
Salulini (1709-1780),
Melchior Chiesa, Carlo Monza (1735-1801),
Niccolo Jommelli (1714-1774),
Georg Reutter, Maximilian Hellmann, Antonio Vivaldi (1678-1741) ...
MUSIQUE
Un musicien allemand nommé Pantaleon Hebenstreit construisit un immense instrument. Il mesurait 3 mètres de long. Il était constitué de 260 cordes. Seul un virtuose possédait la capacité d'en jouer. Le roi Louis XIV appréciait beaucoup les prestations du maître Hebenstreit.
Le choix du nom de cette
invention restat longtemps une énigme pour son créateur. La légende raconte que
celui qui le choisit fût le Roi Soleil lui-même.Voici donc un récit de la petite
anecdote:
"Comment
s'appelle votre instrument ? lui demanda-t-il un jour.
Je ne sais pas, Sire, répondit
piteusement le maître Hebenstreit.
Eh! Bien appelez-le pantaleon pour que durant
chaque récital l'on vous rende hommage !"
Ainsi le psalterion géant s'est appelé
pantaleon. Le maître a joué dans plusieurs villes, et pendant
longtemps dans la même ville que Johann Sébastian Bach. A-t-il joué des pièces
de Bach ? L'histoire ne le dit pas mais l'oreille musicale l'espère
!
Que sont devenus ces immenses pantaleons ? Ils ont disparus. Ils étaient trop grands, trop difficile à jouer et presque impossible à accorder. Mais son petit frère, appelé cymbalum hongrois, existe toujours, et il sert surtout à animer des scènes de folklore.
 |
Canzi Àgost (1808-1866) Vendange en région de Vàc détail d'un Tryptique Détail |
Le cymbalum était un
instrument populaire de petite taille, parfois portatif pour accompagner des
fêtes paysannes, mariages, vendanges... Il était souvent l’œuvre de son
interprète, trop peu connu du grand publique pour être produit par les
ébénistes. Dés le XVIIIe
siècle, les orchestres tziganes l'adoptent et leurs virtuoses
mettent au point un nouvel effet très particulier : le tremolo.Celui-ci
accompagne admirablement des instruments comme le violon et la contrebasse sur
des morceaux de musique populaire .
MUSIQUE
Les instruments contemporains peuvent dater du début des années 1900. A cette époque on l'enseignait déjà dans les écoles de musique. Mais la relève était aussi assurée par le Hackbrett qui est toujours utilisé pour le folklore dans les pays alpins.
Mais comment les cymbalistes habitués à jouer du folklore ont-ils retrouvé la musique plus ancienne ?
Ce progrès eut
lieu en Suisse et à
Paris au début du siècle. Un cymbaliste
hongrois, Rácz Aladár, jouait du folklore et des improvisations dans différents
cafés. Un jour chez un bouquiniste, il découvrit tout un carton de vieilles
partitions pour quelques sous. Ayant ainsi trouvé de magnifiques pièces de
musique dans cette boîte, comme par exemple des oeuvres de clavecinistes
français: Couperin, Rameau, Daquin, D'Andrieu etc. Avec les encouragements du
chef d'orchestre, Ernest Ansermet, il commença à les jouer et il pût conquérir
un public plus large. D'autre part de grands compositeurs comme Debussy, Ravel,
Stravinsky, Bartòk et Kodàly composèrent pour cymbalum.
De notre temps, depuis les années
60 le cymbalum vit sa renaissance grâce aux nombreux compositeurs contemporains
comme Kurtàg, Boulez etc.